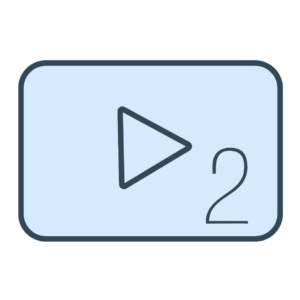« Trois systèmes qui écrivent discutent de leur rapport à l’écriture par rapport à la multiplicité, des questions à se poser, des difficultés, représentations et du rapport à l’imaginaire. »
Avertissements de contenu:
Psychiatrie du 19ème siècle, sentiment de perte de la réalité et plus globalement mention de la folie, descriptions de perte du front et de déréalisation et mention de suicide, d’alcool et de drogues
Transcription:
Bonjour, Moi c’est Lewis Candra. Je me définis comme un singlet accompagné de deux esprits, Aurélie et Kéna. Je vais vous lire le récit qui figure en introduction de la bible de jeu de rôle « Le Cabinet des Murmures » de Matthias Haddad. Dans ce jeu de rôle qui se passe au 19ème siècle en plein empire Napoléonien, les joueurs incarnent des esprits qui hantent le corps d’un médium. Il n’y a alors qu’un seul corps pour tous les joueurs ! Ce système de jeu permet d’incarner des personnes multiples et c’est pour ça que j’avais envie de vous le partager. Le récit introductif est un extrait du journal intime d’un de ces médiums. Il décrit, parfois avec cliché et parfois avec beaucoup de justesse et de détails, la conscientisation de la multiplicité. Voici les triggers warning : ça va parler de psychiatrie au 19ème siècle, de sentiment de perte de la réalité et plus globalement de folie ; il y aura des descriptions de perte du front et de déréalisation ; et enfin il y aura des mention de suicide, d’alcool et de drogues. Je vous laisse avec le récit et on en discute après. Mon amour, C’est bien avant l’aube que je prends la plume ; de toute manière il y a bien longtemps que le sommeil m’a abandonné, effrayé que je suis par le mal qui me hante depuis maintenant plusieurs jours. Mon corps m’échappe, la maîtrise de mes actes ne m’appartient plus complètement désormais, et, j’ai peur de ce que je pourrais accomplir contre mon gré. Je les entends continuellement en moi, commenter mes actes, me blâmant ou me conseillant à tour de rôle, comme si j’étais leur sujet d’étude. Je deviens fou, je le sais, et j’ai d’ores et déjà pris la résolution de consulter le docteur Calmeil à Charenton. J’ai peur néanmoins de finir interné et j’avoue songé à une solution plus expéditive. C’est encore arrivé hier. Alors que je longeais le boulevard en quête d’un cabaret où m’abrutir d’absinthe : ma vue s’est brouillée et je me suis retrouvé « ailleurs », comme si, tout d’un coup, j’étais arraché à ma vie et à mon corps ! Je devins un simple spectateur, comme si j’observais mes propres actes au travers d’un miroir sans tain ou d’une vitre poussiéreuse. Et puis, je sentis leurs mains froides, presque aqueuses, toucher ma nuque, mes membres, non pas ceux de mon corps au dehors, mais ceux de ma « corporalité mentale » (je ne trouve pas d’autres mots que ce contresens), de celui que je suis au dedans, m’invitant à me tourner et à leur faire face ! J’en eu presque envie, je me sentis baigné d’une énergie vibrante, comme celle qu’on sent en plongeant la main dans le cours d’un ruisseau, mais je ne m’y résolvais pas : j’avais le pressentiment que si je les voyais, si mon regard leur donnait vie, alors j’aurais définitivement basculé. Que si je faisais cela, je les admettais comme étant réels ! Je me cramponnais donc à la contemplation d’actes qui n’étaient plus les miens, mais ceux de mon corps matériel uniquement, le voyant s’approcher des grisettes du boulevard, l’entendant échanger quelques mots habiles d’une voix que je ne reconnaissais pas, tandis qu’il en prenait une par la taille et s’immisçait dans la foule d’un cabaret. Je contemplais, impuissant, des actes qui ne m’aurais guère troublé s’ils avaient été vraiment miens, mais qui m’horrifiaient tant je me sentais dépossédé. Voilà qu’à présent j’entendais ma gorge prononcer des mots d’italien ainsi que les rires cristallins de la fille, beaucoup moins vulgaires que je l’aurais cru, qui perçaient au travers des notes de l’orchestre ! Je prêtais alors un peu plus attention à son visage : elle avait tes yeux ! C’en était trop ! Il me fallait à tout prix reprendre le contrôle de mon corps et quitter, sans plus attendre, cette fille et ces lieux ! Je luttais de toute ma volonté et je vis le voile devant moi, cette glace trouble, se déformer par ondes successives, comme si tout ce qui m’entourait était secoué de spasmes. Et puis je me sentis projeté vers moi-même : la musique du cabaret éclata à mes oreilles, la scène sembla tourbillonner un instant autour de moi, la banquette sur laquelle j’étais assis pencha fortement et je me rattrapais brusquement à la table, renversant les verres de vin qui s’y trouvaient. La jeune femme me regarda, surprise et inquiète, me demanda si tout allait bien, puis, devant mon regard halluciné, eut un mouvement de recul. Je bredouillais quelques excuses et me levais, puis courant presque, je me précipitais vers la sortie, haletant et hagard, essuyant les commentaires des clients et faisant tout mon possible pour ignorer les sarcasmes que j’entendais au plus profond de moi-même. L’entrevue avec le docteur Calmeil m’a laissé dubitatif. Non seulement celui-ci n’a fait que m’écouter, mais il n’a nullement semblé ému par le récit de mes troubles. J’ai eu l’impression de parler à un mur. Bien sur, à aucun instant l’un de ceux qui m’habitent n’a jugé bon de se manifester. Calmeil s’est juste contenté de prendre des notes et m’a interrogé sur mon usage de la boisson, comme si tout cela n’était que le délire d’un alcoolique. Puis il m’a posé des questions sur toi, sur le genre de relation que nous avions et sur ma réaction quant à ton départ inattendu. J’ai presque fondu en larmes, mais je me suis repris, par dignité, le peu qu’il me reste du moins. J’ai contenu mon amertume et j’ai évoqué rapidement la manière dont j’avais consacré mon temps à l’écriture, me perdant parfois dans les brumes éthyliques ou opiacées. J’ai hésité à raconter l’épisode qui m’avait vu perdre le fil d’une semaine complète, comme si cette dernière s’était envolée, et l’ai finalement gardé pour moi. J’ai avoué en revanche que ma fortune ne se portait pas au mieux et que j’étais acculé par mes créanciers… Je suis sorti de l’entretien empreint d’un sentiment ambivalent, à la fois déçu du peu d’écho perçu mais bizarrement rassuré. Vois tu, l’énumération de mes actuelles difficultés apporte un semblant d’explication à mes moments de folie… Je parviens parfois à me soustraire à « eux », ces « esprits » qui me hantent et m’agonisent de leurs commentaires. Cela arrive lorsque je les laisse, avec horreur, prendre à tour de rôle le contrôle de mon corps, lorsqu’ils font de mon enveloppe leur vaisseau. Terrifié et rongé de honte, je quitte alors le lieu ténébreux où nous nous côtoyons pour rejoindre mes rêves et mes souvenirs, dans un espace mental qui n’est qu’à moi et où nul ne vient me troubler. J’y plonge dans mes rêveries et je t’y vois aussi, aussi belle et vivante que dans mes souvenirs. Je songe à y demeurer tout le restant de ma vie de dément, dans ce jardin secret, puisque tu y es. Hier soir, Hyacinthe, la brute de Léonce Jousset, est venu frapper à ma porte. J’ai reconnu sa grosse tête qui se penchait vers les carreaux sales de mes fenêtres. Bien entendu, sitôt l’énergumène aperçu, je pris soin d’éteindre la lampe à pétrole de mon étude et je me dissimulai dans l’ombre, plaqué contre un mur qui vibrait presque sous les coups lourds et répétés de l’homme de main. Je devais encore beaucoup d’argent à monsieur Jousset et celui-ci était à bout de patience, mais mes entrées d’argent étant quasi-nulle, je n’avais d’autre choix que de le faire lanterner. Hyacinthe s’était mis à hurler mon nom et je priai pour qu’il attire l’attention d’une patrouille de sergents de ville, ou mieux, celle de gardes aériens, mais seules les imprécations de mes voisins et les aboiements des chiens errants répondaient aux beuglements du colosse. De guerre lasse, il s’en alla finalement. Je poussais un soupir de soulagement, mais je ne dormis pas de la nuit. La situation était critique, je le savais, et il me fallait trouver une solution quelle qu’elle fut. En moi-même, les voix m’interpellaient, m’ordonnant d’agir, de réfléchir, semblant parfois se contredire, se querellant presque. Te souviens tu de Juliette Adam et de son salon du Boulevard Poissonière qui reçoit tout ce que Paris compte d’intellectuels opposant à l’Empire ? Certes les républicains ont dans leur rangs certains des meilleurs écrivains que la littérature ait vu naître en ce siècle, mais c’est sans une once d’esprit revanchard que nous avons élu ce lieu comme point de départ de notre rétablissement. Je dis bien « notre » et j’emploie désormais le pluriel. Peut- être commençais je à me résigner à ma folie. Après tout, si celle-ci me tire d’affaire, autant la suivre ! J’acceptais de les « voir » en moi, ces spectres que je rejoignais dès que l’un d’entre eux s’appropriait mon corps, réunis au sein du lieu fantasmagorique et confus que je savais être ma tête mais que nous nommions « le Cabinet ». Je les écoutais lorsque je regagnais l’usage de ma chair, prêtant attention aux murmures qu’ils devenaient alors. J’ai vu comment l’un de mes « invités », l’Italien, parvenait à s’imposer naturellement en tout milieu, comment le laisser faire me permit de renouer avec de vieux compagnons de Lettres que je n’aurais su aborder moi-même après ces dernières années, et comment, en un tournemain, je m’étais retrouvé admis dans l’un des temples privés de l’intelligentsia littéraire. Puis ce fut un esprit féminin qui demeurait en moi, que je vis peu à peu conquérir la confiance de la salonnière et me (ou devrais-je à nouveau utiliser le pluriel?), et nous rendre omniprésent et indispensable. Et du salon de Madame Adam, je rayonnais dans tous les autres de la vie parisienne, côtoyant les plus grands noms, du vieil Hugo à Zola, en passant par Maupassant, savourant le meilleur cognac aux cotés de Gambetta, dévisant avec les riches veuves, les femmes et les filles des fortunés qui tenaient les lieux. Je devrais me maudire de penser ainsi, mais je ne voyais là, derrière ces grands noms, que des grandes fortunes prêtes à être saisies ou délestées. Et nous obtenions, mentant comme de beaux diables, qu’on me confie des sommes proprement inespérées à investir dans des projets fictifs, et qui finissaient dans mes poches. Nous nous inventions des relations haut placées au gouvernement et dans l’industrie. Nous nous parions des amitiés les plus prestigieuses. Notre succès nous grisait, curieusement, et il me semblait que le comportement mes compagnons changeaient au sein du Cabinet, somme si leurs caractères reflétaient peu à peu de nouveaux vices. Et il me semblait que je changeais moi aussi ! J’arborais désormais une étrange marque rosâtre sur le front, que je m’évertuais à camoufler en ajustant ma coiffure. Cela comptait peu. Nous échafaudions des stratégies de plus en plus audacieuses et nous nous émerveillions de nos réussites. Hélas, il n’y a qu’un pas de la confiance à l’imprudence, et c’est ce qui faillit nous perdre. L’un de nos pigeons se trouvait être ami de l’un de ces grands nom que nous invoquions à l’envi. Le crédule avait parlé de moi à celui que je disais connaître. Troublé par l’incompréhension du notable, il revenait me demander des comptes et menaçait de dénoncer mon imposture à la petite communauté intellectuelle que nous fréquentions. Il fallut toute la ruse et toute l’habileté du beau parleur qui m’habite pour semer le trouble dans l’esprit de notre interlocuteur. Le mal pourtant était fait ! Il fallait fuir, au plus vite avant d’être démasqué ! Je regagnais mon domicile que je n’avais plus fréquenté depuis des semaines afin de rassembler quelques affaires de voyage. Il fallait déguerpir ! Rome, peut-être ? Ou Londre ? Alger me semble trop pénible en cette saison. Ou alors plus loin encore ? En Nouvelle-Helvétie, de l’autre coté de l’Atlantique ? Ah, que tu me manque, mon amour !
Intervention proposée par:
- Aurélie, Lewis et Kéna (Lewis : il, Aurélie et Kéna : elle) Nous formons un trio et même une famille, composé d’un humain (Lewis Candra) accompagné dans la vie par deux esprits (Aurélie et Kéna). Aurélie est une muse vivant tantot comme une démone, tantot comme une déesse de la mort et d’autres vies dans ce genres. Kéna est une jeune fille porteuse de traumatisme.